Klaus Schulze – Shadowlands
Klaus Schulze
Synthetic Symphony
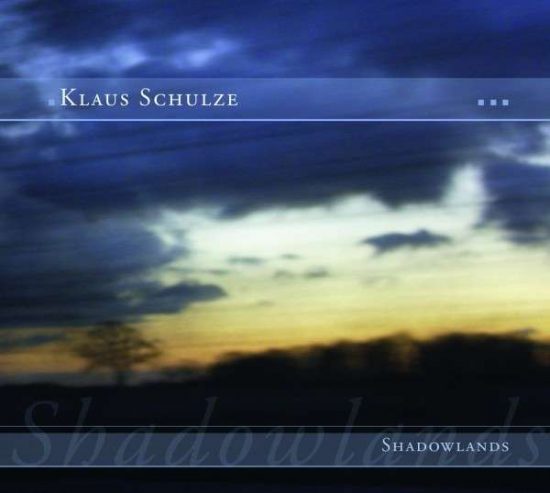
Pour moi, Klaus Schulze est très certainement l’artiste qui incarne le mieux l’imaginaire en matière musicale, celui qui m’a fait jadis perdre pied dans des univers sonores dont je ne soupçonnais même pas l’existence. Il est aussi celui qui m’a ouvert les portes vers une autre manière d’écouter et d’expérimenter la musique. J’ai découvert ce pionnier de l’électronique planante durant mon adolescence, alors que j’étais un jour en compagnie de deux amis et complices mélomanes, à partager dans la chambre de l’un d’eux nos récentes découvertes numériques (nous étions ici dans les débuts du CD), parmi lesquelles trônait le dernier Jean-Michel Jarre. Le père d’un de mes deux acolytes, constatant notre ignorance de jeunesse en soupirant depuis l’étage du dessous, ne tint plus et monta nous rejoindre avec une cargaison de vieux vinyles sous le bras, parmi lesquels une sélection de classiques absolus du maître berlinois. Avec un bel accent du sud ouest, nous avons eu droit à une formule du genre « Bon, enlevez-moi tous vos machins là, et écoutez-donc ça plutôt, vous allez voir putain con, c’est SUPER !« . S’en est suivi un véritable rituel de passage collectif, un pur moment initiatique gravé à jamais dans nos mémoires, au cours d’un simple après-midi pluvieux qui aura une influence déterminante sur tout ce qui va suivre et nous passionner musicalement parlant jusqu’à aujourd’hui (c’est beau quand même, la transmission, quand c’est bien fait !).
Vont se succéder alors durant des heures entières sur la platine, sous nos oreilles et yeux ébahis par les fabuleuses pochettes (la triste dématérialisation des supports ne permettra jamais ça !), quelques pièces aussi majeures que « Cyborg », « Picture Music », « Moogetique » (extrait de « Body Love Vol.II ») et autres « Timewind », avec le récit complet des expériences cosmiques vécues durant les seventies par notre formateur improvisé, que personnellement je ne remercierai jamais assez. Le lendemain, je me ruais dans une Fnac parisienne faire l’acquisition de « Body Love », qui reste à ce jour mon œuvre préférée de Klaus Schulze. Il me faudra peu de temps ensuite pour entamer puis me constituer une collection riche et fétiche, que vient compléter, quelques 25 ans plus tard, ce magnifique « Shadowlands », dernière livraison du maître au sommet de sa forme créative.
Et entre temps, combien d’heures passées à lire la saga « L’Incal » de Moebius et Jodorowsky en écoutant « En=Trance » ou « Dresden Performance » ? A plonger dans les escapades spatio-temporelles de Valérian et Laureline signées Mézières et Christin, sur les sonorités robotiques et les rythmes futuristes de « Dig-It » et « Trancefer » ? Et le plus souvent à m’inventer mes propres aventures intérieures, science-fictionnelles ou fantastiques, sur les nombreux incontournables de Klaus Schulze ? « Imaginaire », oui, c’est bien le maître mot pour qualifier la musique du compositeur allemand, qui du haut de ses 65 ans bien tassés, continue aujourd’hui encore à le stimuler comme personne, pour peu qu’on prenne le temps de s’abandonner dans les méandres de son art.
Comme il l’avoue lui-même, l’homme ne sait pas faire court, et ce n’est pas le caractère fleuve de ce nouvel opus qui témoignera du contraire. Six ans après l’excellent « Kontinuum », dernière opus solo en date et retour aux heures de gloire aussi réussi que nostalgique (l’album ressemble bien davantage à un « Mirage » paru en 1977 qu’au « Moonlake » de 2006 !), « Shadowlands » se décline en deux éditions, l’une simple avec 3 longs titres, l’autre double (et limitée à 3000 exemplaires), pour un total de 2h30 de musique. Il est clair que les fans purs et durs se précipiteront sur la seconde, d’autant plus que les deux plages additionnelles sont d’aussi bonne tenue que le matériel de l’album « officiel », et que de fait elles rendent l’acquisition de cette version copieusement augmentée indispensable pour tout le monde.
« Shadowlights » ouvre le bal du haut de ses 41 minutes enchanteresses d’un bout à l’autre. Il s’agit là d’une longue suite au déploiement très « progressif », introduite par des nappes majestueuses, puis animée par un lent tempo hypnotique délicatement posé sur des alternances d’accords synthétiques sublimes, par dessus lesquels viennent dialoguer le violon en apesanteur de Thomas Kagermann, sa propre voix, ainsi que celle, plus mystique que jamais, de la grande Lisa Gerrard (Dead Can Dance). La célèbre vocaliste australienne se fait toutefois ici davantage « discrète » qu’à travers ses dernières réalisations cosignées avec Klaus Schulze, avec lequel elle aura entamé une fructueuse collaboration depuis 2008 et le double « Farscape », avec en points d’orgue deux albums live d’excellente facture.
« In Between » poursuit la symphonie électronique avec son premier mouvement aussi étrange qu’irréel, entremêlant échos de voix réverbérées et oscillations électroniques, avant l’entrée en scène des fameuses séquences programmées, marque de fabrique éternelle du roi indétrônable de la Berlin School. Puis le long voyage onirique se prolonge sans transition avec « Licht und Schatten », enchainé au titre précédent, où nappes, séquences et voix éthérées se voient renforcées par des percussions qui ne sont pas sans rappeler la « patte » de Michael Shrieve sur l’indispensable « Transfer Station Blue » (1985), album studio du batteur sur lequel Klaus Schulze est omniprésent.
Les deux titres « bonus » qui, cumulés, sont quasiment d’une durée équivalente à l’album en version simple, se voient parés des mêmes textures sonores, renforçant ainsi l’homogénéité de l’œuvre et le sentiment d’avoir affaire à un authentique double album. « The Rhodes Violin » (55 minutes au compteur quand même !) est une pièce exceptionnelle et typiquement Schulzienne dans sa structure, quant au très serein « Tibetan Loops », dénué de toute séquence rythmique, celui-ci se révèle le titre le plus « ambient » du lot. Dans les deux cas, Klaus Schulze y enrichit son univers électronique lyrique et immersif de discrètes influences orientales, à base de violon et de ponctuations vocales jamais envahissantes.
Au final, pas une minute n’est à jeter dans cette nouvelle création studio du maître, qui synthétise (c’est le cas de le dire !), tout ce qu’il a fait de mieux ces 20 dernières années en terme de composition et de production. L’artiste y déploie une palette sonore intemporelle, esthétique en diable et jamais pompeuse, comme cela fut parfois malheureusement le cas entre 1985 et 1995, seule véritable période d’errance artistique de ce génie de la musique électronique.
Sans être furieusement innovant, mais réalisé avec un savoir-faire qui force le respect, « Shadowlands » est encore un de ces albums brillants qui stimulent l’imaginaire comme bien peu savent le faire. Il est aussi un nouveau classique définitif dans la discographie du grand Klaus, dont le génie et le talent n’ont d’égal que l’extrême humilité. Indispensable !
Philippe Vallin (9/10)
[responsive_vid]

Merci Philippe de cette chonique bien complète et détaillée ! Ca donne envie de s’y replonger de suite… Olivier Bégué
Que d’émotions Philippe !! Cela me rappel mes souvenirs 😉
Merci pour ce partage.
Bien à toi,
Sequentia Legenda